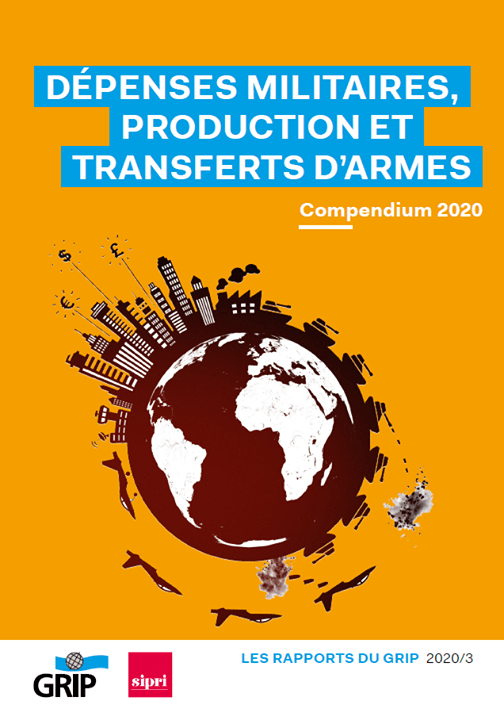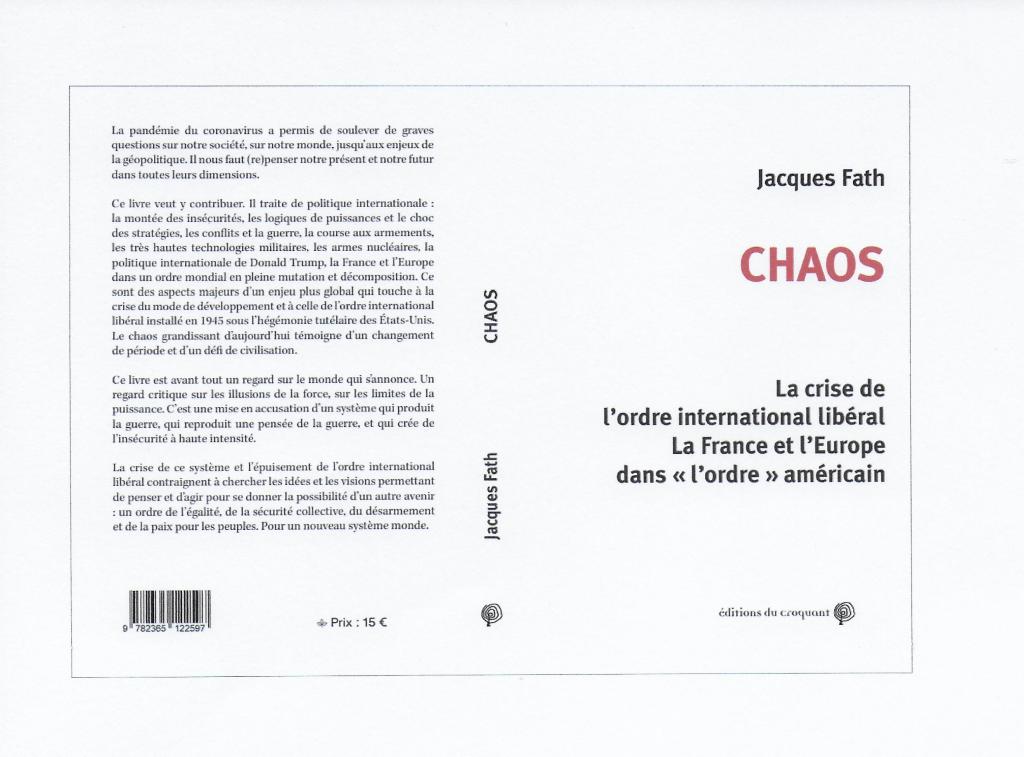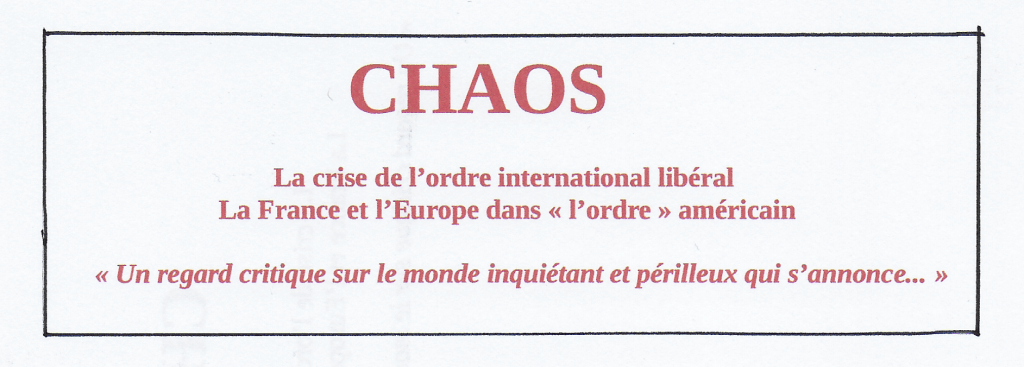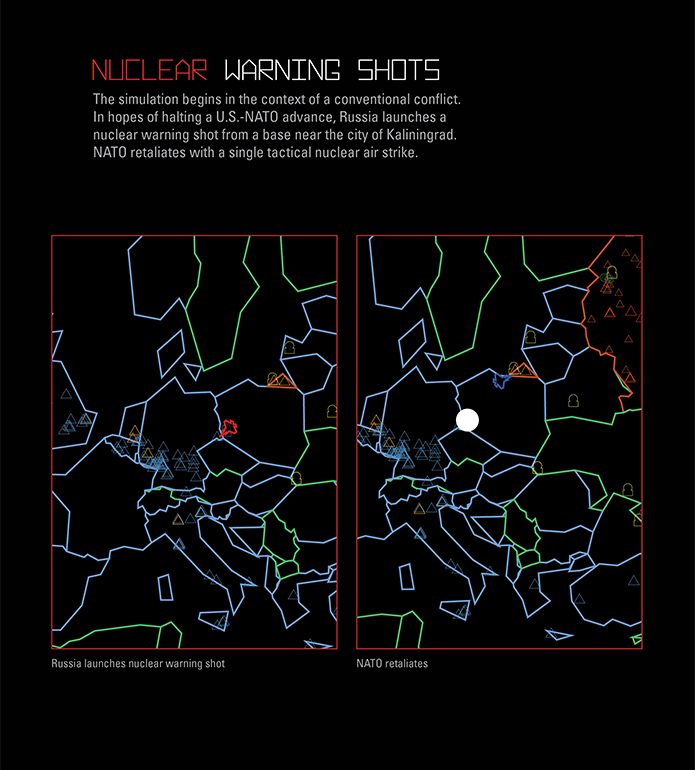L’Union européenne a rendu public le 8 décembre 2020 une déclaration de son Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (Josep Borrell), à propos de l’installation d’un régime de sanctions de l’UE concernant la défense des droits humains sur le plan mondial (EU Global Human Rights Sanctions Regime).
L’UE a décidé ainsi la mise en place d’un régime de sanctions, en tant qu’instrument « additionnel » de l’UE, afin de défendre ces droits de façon plus tangible et plus directe. Cette initiative est présumée pouvoir modifier le comportement des acteurs (étatiques et non étatiques) visés, et pourrait servir de moyen de dissuasion contre les violations des droits humains les plus sérieuses et contre les mauvais traitements. Il est évidemment positif de vouloir accorder le maximum d’attention à un tel enjeu, mais cette initiative européenne pose de multiples problèmes.
L’initiative de l’UE s’appuie sur la persistance de « violations graves des droits humains et de mauvais traitements » dans le monde. Sont cités expressément : génocides, crimes contre l’humanité, torture, esclavage, exécutions extra-judiciaires, violences sexuelles et fondées sur le genre, disparitions forcées, arrestations et détentions arbitraires, trafics humains. Selon un communiqué de presse de l’UE, d’autres violations des droits ou mauvais traitements pourront faire l’objet de sanctions s’ils s’agit d’actes étendus, systématiques, ou bien s’ils constituent une source de grave préoccupation pour les buts de la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Une remarque s’impose : devant une telle imprécision, on peut craindre qu’un certain arbitraire et des choix purement politiques ne l’emportent. Mais il y a bien d’autres questions.
Premièrement. Sur quelle base juridique l’UE veut-t-elle prendre des décisions de sanctions ? Cette question est incontournable pour des instances européennes qui font de l’État de droit, et plus généralement du droit, un paramètre fondamental de leur activité. Et puis, il serait légitime que l’application de sanctions ne soient pas, ou ne soit plus (comme c’est en général trop le cas aujourd’hui) le résultat de choix politiques discrétionnaires et unilatéraux. Mais force est de constater que l’initiative de l’UE ne fait référence ni à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 10 décembre 1948, ni aux principes de la Charte des Nations-Unies. Elle ne cite pas non plus les statuts de la Cour Pénale Internationale (CPI), alors que l’initiative de l’UE vise ce qu’elle appelle « les violations graves des droits humains », soit une formulation assez proche de celle de la CPI.
En vérité, la liste des violations des droits humains pouvant faire l’objet de sanctions de la part de l’UE n’est pas réellement fixée. Elle ne s’appuie ostensiblement, comme référence essentielle, sur aucun des grands textes existant portant sur les droits fondamentaux. Cette liste de l’UE balaie un champ de droits nettement moins étendu que celle définie par la DUDH. Elle n’inclut pas, par exemple, les droits sociaux, le droit d’asile, les discriminations, le droit à la nationalité… Est-ce une façon d’éviter des problèmes gênants ? Cette liste est en revanche nettement plus large que les quatre incriminations visées expressément par les statuts de la CPI : génocides, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, et crimes d’agression. On a le sentiment que la liste de l’UE ressort des préoccupations politiques de quelques dirigeants, plutôt que d’une volonté de rigueur juridique. L’imposition de sanction a pourtant besoin de légalité et de légitimité.
Deuxièmement. Une référence explicite aux Nations-Unies, à sa Charte, à ses principes aurait été bienvenue. Elle aurait permis à l’UE d’affirmer explicitement que les droits à l’autodétermination, à la souveraineté et à l’indépendance, absents de l’initiative de l’UE, sont tout de même pris en considération grâce à d’autres textes fondamentaux que l’UE se doit se d’appliquer. Mais il n’en est rien. La carence est ici béante. Il y a, là encore, un sérieux problème. Pourquoi ? On sait qu’Israël commet de graves violations des droits humains au point où, en 2019, la CPI a ouvert une enquête pour crimes de guerre dans les territoires occupés militairement et à Gaza sous blocus. Faute de préciser clairement que son initiative concerne aussi des territoires occupés et les politiques d’occupation, l’UE saura utiliser une certaine marge d’appréciation pour écarter toute procédure de sanctions contre Israël, alors que cet État bafoue non seulement la DUDH, les statuts de la CPI, mais aussi l’Accord d’association UE/Israël rentré en vigueur le 1er juin 2000. L’article 2 de cet accord stipule, en effet, que « les relations entre les parties, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des Droits de l’homme et des principes démocratiques, qui inspirent leurs politiques internes et internationales et qui constitue un élément essentiel du présent accord ».
Certes, Israël n’est pas membre de la CPI, mais cet État ne peut pas prétendre qu’il ne serait pas concerné par des sanctions si d’aventure l’UE avait le courage de vouloir lui en imposer… Rappelons d’ailleurs qu’une résolution du Parlement européen en date du 10 avril 2002, demandait déjà la suspension de l’accord d’association UE/Israël comme sanction du non respect de la clause sur les droits de l’homme (article 2) de cet accord.
Notons encore que l’UE a signé un accord de coopération et d’assistance avec la CPI. Elle a pris l’engagement « d’appuyer le bon fonctionnement de la CPI et à promouvoir un soutien universel en sa faveur en encourageant la participation la plus large possible au statut de Rome ». Question : l’UE va-t-elle aider la CPI à mener l’enquête sur les crimes de guerre d’Israël en Palestine ?
On observe donc :
– 1) que le régime de sanctions installé par l’UE, ce 8 décembre 2020, pourrait être considéré comme juridiquement inadapté à une mise en cause des crimes israéliens de l’occupation et de la colonisation.
– 2) que l’accord d’association UE/Israël n’est toujours pas respecté concernant la disposition sur les droits de l’homme et la démocratie.
– 3) qu’il n’y a aucune garantie que l’UE puisse décider d’aider la CPI à enquêter sur les crimes de guerre israéliens en Palestine.
Israël peut dire merci à Bruxelles qui lui donne, et qui se donne à elle-même, suffisamment d’imprécision et de flou pour pouvoir enterrer, en tant que de besoin, toute velléité de sanction.
Troisièmement. L’UE précise dans son initiative que l’application de sanctions sera conforme à l’approche de la Politique étrangère et de sécurité commune. Les décisions seraient donc d’abord guidées par des choix et des orientations politiques ? Cette situation pose un très sérieux problème puisque la PESC se caractérise par une inaction européenne caractérisée concernant, par exemple, les droits des Kurdes, des Sahraouis et ceux des Palestiniens. Pour être plus conforme à la réalité, disons que cette politique se manifeste plutôt comme celle d’un soutien effectif à ceux qui bafouent les droits essentiels de ces peuples.
De quelle crédibilité l’UE pourra-t-elle se réclamer si elle persiste ainsi à montrer qu’elle se refuse, dans les textes et dans les faits, à sanctionner Israël pour les crimes commis dans le cadre de la politique d’occupation et de colonisation, en contradiction avec ses propres engagements de principe. On ne peut, à la fois, se déclarer déterminés à « promouvoir les droits humains partout dans le monde », comme le répète l’UE, et contribuer à l’impunité d’un État, pourtant juridiquement et politiquement associé, qui bafoue tout à la fois, depuis des dizaines d’années, les droits édictés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, les principes rappelés dans la Charte des Nations-Unies, les droits fondamentaux énumérés par les statuts de la CPI, et l’accord d’association signé avec l’Union européenne.